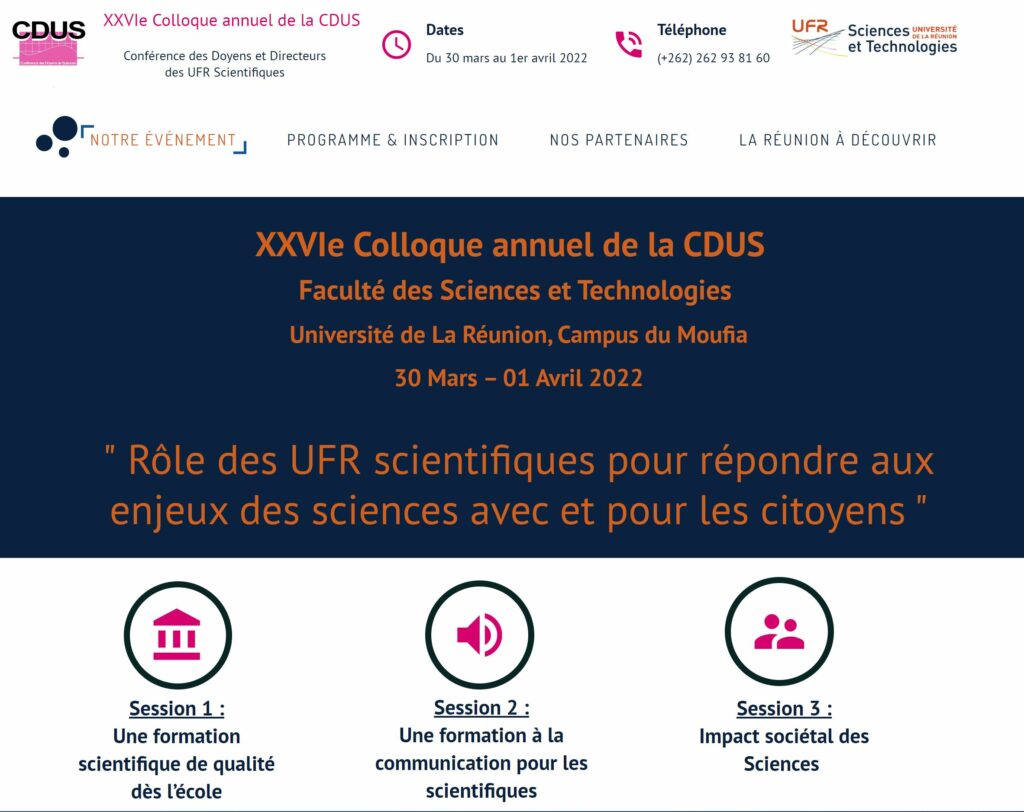Cliquez ici pour une version PDF du communiqué.
Un profond mouvement de transformation des structures universitaires est à l’oeuvre, notamment impulsé par les différents appels des programmes d’initiatives d’excellence : IDEX, ISITE, EUR, NCU… La CDUS a largement démontré sa capacité de proposition en répondant activement à plusieurs appels, et les Facultés scientifiques sont des moteurs sur tous les sites où elles sont présentes.
Mais il est également de notre responsabilité d’alerter Mme la Ministre, ainsi que les responsables des différents sites, sur les risques liés à une mise en oeuvre précipitée des restructurations. Bâtir des projets au niveau des stratégies d’établissements ne suffit pas ; leur réussite à court, moyen et long terme ainsi que la continuité des missions de service public passe de manière indispensable par une large association des Facs de sciences depuis la définition stratégique des évolutions jusqu’à leur mise en oeuvre.
Par ailleurs, nous sommes en mesure d’observer certains invariants dans plusieurs projets, conduisant notamment à une remise en question des modèle scientifiques, pédagogiques et démocratiques des UFR, tels que la séparation du continuum licence – master ou le passage d’activités des UFR dans un modèle « d’Ecole » sélectives. Si nous sommes ouverts aux expérimentations (et nous l’avons déjà démontré au travers par exemple du College “sciences” de l’université de Bordeaux, intégré et actif dans notre réseau des Facs de sciences), nous souhaitons rappeler que nos Facultés ont su allier depuis de nombreuses années l’excellence sociale, professionnelle et académique. Principales vecteurs d’ascenseur social pour les étudiants, principales pourvoyeurs de cadres scientifiques pour les entreprises et de chercheurs pour les laboratoires, elles offrent aux enseignants-chercheurs qui en sont membres la possibilité de conduire des carrière diverses et équilibrées entre leurs différentes missions, en fonction de leur curseur d’intérêt. C’est pourquoi nous demandons qu’une attention particulière soit accordée sur la pérennité de ces identités dans les modèles expérimentaux qui sont explorés sur les différents sites.
Il ne s’agit pas de demander un retour en arrière vers un modèle purement « facultaire », mais bien de préparer l’avenir avec de grands ensembles scientifiques au sein des universités, alliant licence master et doctorat, ayant une compétence recherche, et qui soit garant de la cohérence globale des activités d’enseignement supérieur dans le grand champ des sciences et technologies. La CDUS se tient à la disposition des porteurs de projets pour travailler dans ce sens, et suivra avec attention les évolutions concernant les Facs de sciences du territoire.
Une méthode inacceptable à l’Université LYON 1
C’est dans ce contexte que la CDUS tient à attirer l’attention concernant la situation du projet “Université Cible” du site de Lyon / Saint-Etienne. En effet, une évolution majeure de la Faculté des Sciences et Technologies est annoncée au premier janvier 2019, en interne de l’Université LYON 1 : séparation du cycle licence, séparation des disciplines dans trois composantes selon un logique sciences de la vie, sciences de l’ingénieur, sciences fondamentales.
Les conditions de démocratie, de transparence et de dialogue dans lesquelles cette transformation est conduite ne sont pas acceptables. Ainsi la CDUS soutient la demande des personnels de la Faculté des Sciences et Technologies de Lyon 1 auprès du Président de l’Université LYON 1 de ne pas amorcer de changement structurel qui entrerait en vigueur AVANT que l’organisation de « l’Université Cible » ne soit connue, et approuvée par un consensus des cinq établissements membres du rapprochement.
Ce temps nécessaire est celui de la participation réelle des communautés au projet et de la préparation des personnels aux changements, au premier rang desquels les personnels administratifs et techniques. Rappelons que les UFR sont des structures du code de l’éducation, dont toute évolution doit être annexée au projet d’établissement ; et doit faire l’objet d’un travail en amont avec la direction de l’UFR et les instances consultatives de l’établissement : le conseil des directeurs de composantes, le conseil académique, le CT, le CHSCT.
La bonne marche de nos universités est dépendante d’un climat de confiance entre les composantes et les présidences.
Approuvé en Assemblée Permanente de la CDUS, Paris le 18 octobre 2018